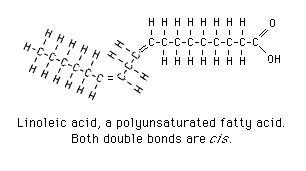Dans la partie précédente, nous avons remarqué que les lipides alimentaires sont incorporés dans les tissus, et que différents types de lipides ont des effets biologiques différents.
Nous avons également constaté que les acides gras polyinsaturés ont des effets toxiques sur la plupart des systèmes biologiques, incluant les mitochondries, la glande thyroïde, le foie, et le système fibrinolytique, et que les acides gras saturés ont des effets opposés et protecteurs.
La question qui se pose est donc la suivante: si ces observations sont publiées dans la littérature scientifique depuis 20, 50 et même 100 ans, pourquoi entend-on le gouvernement, les nutritionnistes et les médecins nous exhorter d'éviter les gras saturés comme le beurre? Et de les remplacer par des huiles végétales et des margarines riches en gras polyinsaturés?
La réponse officielle est que les gras saturés ont tendance à augmenter le taux de cholestérol sanguin alors que les gras polyinsaturés ont tendance à le diminuer.
Ainsi, nous disent les experts, les gras saturés ont tendance à augmenter le risque de souffrir de maladies cardiovasculaires alors que les gras polyinsaturés diminuent ce risque.
On sait que depuis 50 ans, le cholestérol sanguin est considéré comme le vilain en médecine. On cherche à le diminuer, par l'alimentation d'abord, et quand ça ne fonctionne pas, par des médicaments.
À travers tout ça, personne ne semble se demander s'il s'agit d'une bonne idée, ou si cette idée est appuyée sur des données plausibles.
Pourtant, la littérature scientifique recèle d'importantes informations à ce sujet.
Nous en explorerons une partie ici.
Il est souvent mentionné que les pays Occidentaux souffent davantage de maladies cardiovasculaires parce qu'ils consomment beaucoup de gras saturés et de cholestérol.
Lorsqu'on regarde les données, cette supposition fond comme neige au soleil. En effet, en Suisse entre 1951 et 1976, la mortalité cardiovasculaire a diminué alors que la consommation de gras animal a augmenté de 20% (1).
En Angleterre, entre 1910 et 1970, la consommation de gras animal est demeuré à peu près constante, alors que la quantité de crises cardiaques a presque décuplé (2)!
En Inde, une étude épidémiologique suivant plus de 1 million d'employés de chemin de fer a observé que les habitants du Madras souffraient de 700% plus de maladies cardiovasculaires que les habitants du Punjab. Toutefois, les Punjabis consomment de 1000 à 2000% plus de gras animal et fument 800% plus de cigarettes que les habitants du Madras (3)!
Si on regarde du côté des pays de la Méditerranée, où existe une alimentation supposément idéale d'où sont exclus ces méchants gras saturés, on constate d'autres surprises.
En Italie, la consommation de gras saturé a augmenté de 69% entre 1961 et 1985 alors que la mortalité due aux maladies cardiovasculaires a chuté de 61% entre 1965 et 1992.
Au Portugal, dans la même fourchette d'années, la consommation de gras saturé a augmenté de 10% alors que la mortalité cardiovasculaire a chuté de 46%.
En France, pour la même période, la consommation de gras saturé a augmenté de 28% alors que la mortalité cardiovasculaire diminuait de 20% (4).
Finalement, au Japon, la consommation de gras saturé a augmenté de façon substantielle depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, mais leur mortalité cardiovasculaire a chuté de façon spectaculaire pendant ce temps.
L'étude la plus souvent citée dans le cadre du débat cholestérol-maladies cardiovasculaires est l'étude de Framingham.
Commencée en 1948 dans la ville de Framingham, Massachussets (et encore active aujourd'hui), cette étude a fourni une mine de statistiques concernant le cholestérol et les maladies cardiovasculaires.
En 1970 (après 22 ans), un rapport préliminaire concluait: 'There is, in short, no suggestion of any relation between diet and the subsequent development of CHD in the study group.'
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien observable entre l'apport en cholestérol, gras saturés et calories totales et la propension à souffrir de maladies cardiovasculaires chez les citoyens de Framingham (5).
Finalement, en 1997 (après 49 ans d'étude!), un autre rapport publié dans le Journal of American Medical Association (JAMA) montrait qu'à Framingham, un apport plus élevé en gras saturé protégeait des accidents vasculaires cérébraux (6).
Donc, il est difficile d'utiliser les résultats de l'étude de Framingham pour affirmer que le cholestérol constitue un danger pour la santé cardiovasculaire!
Une autre étude, moins connue du grand public mais tout aussi dispendieuse et importante, a débuté en 1972 sous le nom de Multiple Risk Factor Intervention Trial (MR FIT).
L'étude a couté 115 millions de $ US (C'était beaucoup d'argent en 1972!) et a recruté 13000 sujets parmi 361 000 candidats. Les sujets choisis étaient considérés comme les plus à risque de souffrir d'une crise cardiaque: leur taux de cholestérol était plus élevé, ils fumaient, étaient inactifs physiquement, faisaient de l'embonpoint, et consommaient plus de gras saturé et de cholestérol. En recrutant les sujets les plus à risque, les chercheurs s'attendaient donc à observer des effets bénéfiques plus importants avec le traitement.
6500 des sujets (le groupe traitement) ont reçu des médicaments anti-hypertensifs, obtenu de l'aide pour cesser de fumer, et ont été suivis par des nutritionnistes pour diminuer leur apport en calories, cholestérol et gras saturé. Les 6500 autres sujets (le groupe contrôle) n'ont reçu aucune directive spéciale et étaient simplement encouragés à continuer à voir leur médecin habituel.
6 ans plus tard, une proportion significative du groupe traitement ont réussi à cesser de fumer, à perdre du poids et à diminuer de façon significative leur pression artérielle par-rapport au groupe contrôle.
Toutefois, les chercheurs ont été obligés de noter qu'il n'y avait pas de différences entre les 2 groupes en ce qui a trait à la mortalité totale ou à la quantité de crises cardiaques:"The overall results do not show a beneficial effect on Coronary Heart Disease or total mortality from this multifactor intervention."(7).
Une façon directe de déterminer si le cholestérol sanguin a une influence sur les pathologies artérielles est de comparer, à l'autopsie, le degré d'athérosclérose présent dans les artères au taux de cholestérol sanguin du patient de son vivant (mesuré préférablement sur plusieurs années).
Ainsi, dès 1936, les Drs Lande et Sperry de l'Université de New York ont exploré cette question.
Ils ont étudié un grand nombre d'individus ayant souffert une mort violente (accident, suicide, etc). Ceci est intéressant parce que des gens de plusieurs groupes d'âges sont ainsi considérés.
Ils ont conclu qu'il n'existait pas de lien entre le taux de cholestérol sanguin du patient de son vivant et le degré d'athérosclérose observé post mortem (8).
Dans les années 1950 et 1960, l'équipe du Dr JC Paterson de London en Ontario a suivi un groupe d'environ 800 militaires à la retraite. Leurs taux de cholestérol sanguin étaient méticuleusement mesurés pendant plusieurs années.
Puis, pour les vétérans décédés entre 60 et 69 ans, une autopsie était pratiquée pour déterminer le degré d'athérosclérose présente dans le système artériel.
La conclusion du Dr Paterson est similaire à celle des Dr Landé et Sperry: aucun lien n'a été observé entre le taux de cholestérol sanguin du patient dans les années précédant sa mort et son degré d'athérosclérose artérielle (9).
Ces résultats ont été corroborés par des équipes de recherche travaillant en Inde (10), en Pologne (11), au Guatemala (12) et aux États Unis (13).
Finalement, on n'entend pas beaucoup parler des dangers d'un BAS taux sanguin de cholestérol. Pourtant, il existe beaucoup d'informations à ce sujet dans la littérature scientifique.
En effet, il est bien connu qu'un BAS taux de cholestérol sanguin augmente la mortalité totale, et surtout la mortalité due aux cancers, aux troubles gastrointestinaux et respiratoires, ainsi qu'au VIH (14), (15), (16), (17), (18) et (19).
Ceci est dû au fait que les lipoprotéines sanguines transportant du cholestérol (les fameux HDL et LDL) sont impliquées dans les défenses immunitaires contre les virus et bactéries.
Un bas taux sanguin de ces molécules rend le système immunitaire moins efficace à combattre ces agents infectieux.
Donc, l'étude de Framingham montre qu'il n'existe pas de lien entre la consommation de calories, gras saturé et cholesterol et le taux de maladies cardiovasculaires.
De plus, l'étude MR FIT a montré que de diminuer drastiquement la consommation de calories, gras saturé et cholestérol n'aiméliore pas la longévité totale ni la santé cardiovasculaire, et ce en dépit de la prise de médicaments anti-hypertensifs et une forte diminution du tabagisme.
Il semble également que le taux de cholestérol sanguin d'un individu ne soit pas lié avec le niveau d'athérosclérose présent dans ses artères.
Finalement, un bas taux de cholestérol sanguin augmente le taux de mortalité, surtout la mortalité liée aux cancers et maladies infectieuses.
Il est important de mettre l'emphase sur les résultats de l'étude de Framingham et MR FIT. En effet, ces 2 études sont considérées comme parmi les plus importantes de l'histoire de la médecine. Elles ont utilisées des quantités sans précédent de fonds publics, ont mobilisé des dizaines de milliers de sujets pendant plusieurs années, voire des décénnies, et employé des milliers de professionnels de la santé et chercheurs afin de recueillir, mesurer, analyser et interpréter les torrents de données générés.
Si des études de cette qualité, durée et ampleur n'ont pas été capables de déceler un lien significatif entre le cholestérol, le gras saturé et les maladies cardiovasculaires, la conclusion raisonnable à tirer est que ce lien n'existe pas, ou bien que s'il existe il est si faible qu'il n'a aucune importance.
À la lumière de tout cela, on est en droit de se demander: sur quoi sont basées les recommendations de santé publique? Et surtout, pourquoi les 'experts' persistent-ils à endosser des politiques qui sont manifestement erronées?
Quand quelqu'un base une carrière prestigieuse sur la base d'une théorie s'avérant ultérieurement fausse, il est de nature humaine de contester l'information niant la théorie en question. En général, on ne mord pas la main qui nous nourrit!
Heureusement, il existe des chercheurs qui ont publié et diffusé des articles réfutant la théorie du cholestérol. On en a considéré quelques-uns plus haut.
Également, des prestigieuses organisations médicales telles que le National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI), l'American Medical Association, la Fondation Canadienne des Maladies du Coeur, et bien d'autres, doivent une grande partie de leur réputation et de leur financement à cette 'guerre' contre les maladies cardiovasculaires.
Elles épousent publiquement la théorie du cholestérol-comme-cause-des-maladies-cardiovasculaires depuis des décennies.
Admettre en bloc avoir fait tout ce temps la promotion d'une théorie fausse, malgré la présence d'une grande quantité d'information contraire, entacherait leur crédibilité et leur réputation de façon irréversible.
Finalement, plusieurs acteurs ont des intérêts financiers dans ce domaine, puisque toute une industrie s'est construite autour du cholestérol.
Les statines, ces médicaments utilisés pour baisser le taux de cholestérol sanguin, sont les médicaments les plus rentables au monde. Lipitor, par Pfizer, a réalisé des revenus de 12,9 milliards de $ US en 2006 (20).
Il est naturel que les firmes pharmaceutiques fabriquant ces produits tiennent à en vanter les vertus, et qu'elles ne feront pas activement la diffusion d'informations pouvant leur nuire.
Également, les compagnies fabriquant des instruments d'analyse sanguine et les laboratoires médicaux ont un intérêt bien évident à ce que les médecins prescrivent une quantité importante et croissante de tests de mesure de cholestérol sanguin.
Enfin, les compagnies agro-alimentaires ayant investi des grosses sommes dans la promotion de produits 'légers' ou 'sans cholestérol' (qui se détaillent à un prix plus élevé mais ne coûtent généralement pas plus cher à produire) ont évidemment à gagner si les gens sont persuadés que le cholestérol est dangereux et qu'il est désirable de chercher à le diminuer par l'alimentation.
Ainsi, l'égo des organisations médicales couplé à la tendance humaine à nier ses erreurs, ainsi que des biais économiques ont retardé de plusieurs décennies la diffusion de l'information connue sur le cholestérol, les gras saturés et les maladies cardiovasculaires.
Cette négligence à considérer des informations publiques a entraîné un gaspillage de sommes faramineuses en médicaments, tests sanguins et autres interventions inutiles, et a incité des millions de gens à modifier leur alimentation de façon potentiellement nocive sans raison valide tout en les exposant à un stress pouvant être bien nuisible et menant dans certains cas à des comportements hypochondriaques.
Finalement, ce gachis de ressources et d'effort a retardé grandement le travail sur les vraies causes des maladies cardiovasculaires, tant occupée la médecine est-elle à pourchasser les chimères que sont le cholestérol et les gras saturés.
C'est là, selon moi, la réelle tragédie de cette histoire.
Références
1) Guberan E. Surprising decline of cardiovascular mortality in Switzerland: 1951-
1976. Journal of Epidemiology and Community Health 1979.;33:114-20.
2) Yudkin J. Diet and coronary thrombosis. Hypothesis and fact. The
Lancet1957;2:155-62.
3) SL Malhotra Epidemiology of ischaemic heart disease in India with special
reference to causation. Br Heart J. 1967 November; 29(6): 895–905.
4) 1986 FAO Production Yearbook 40, 1987.
5) W B Kannel and T Gordon. The Framingham Diet Study: diet and the regulations of serum
cholesterol (Sect 24). Washington DC, Dept of Health, Education and Welfare, 1970.
6) M W Gillman, et al. Inverse association of dietary fat with development of ischemic stroke in
men. JAMA 1997; 278:2145.
7) Multiple Risk Factor Intervention Trial. J A M A . 1982; 248: 1465.
8) Landé KE, Sperry WM. Human atherosclerosis in relation to the cholesterol
content of the blood serum. Archives of Pathology 1936;22:301-312.
9) Paterson JC, Armstrong R, Armstrong EC. Serum lipid levels and the severity
of coronary and cerebral atherosclerosis in adequately nourished men, 60 to 69 years of age. Circulation 1963;27:229-236.
10)Mathur KS, and others. Serum cholesterol and atherosclerosis in man.Circulation 1961;23:847-852.
11)Marek Z, Jaegermann K, Ciba T. Atherosclerosis and levels of serum cholesterol in postmortem investigations. American Heart Journal 1962;63:768-774.
12)Méndez J, Tejada C. Relationship between serum lipids and aortic atherosclerotic lesions in sudden accidental deaths in Guatemala City. American Journal of Clinical Nutrition 1967;20:1113-1117.
13)Cabin HS, Roberts WC.Relation of serum total cholesterol and triglyceride levels to the amount and extent of coronary arterial narrowing by atherosclerotic plaque in coronary heart disease. American Journal of Medicine 1982;73:227-234.
14)Krumholz HM and others. Lack of association between cholesterol and coronary heart disease mortality and morbidity and all-cause mortality in persons older than 70 years. Journal of the American Medical Association 272, 1335-1340, 1990.
15)Jacobs D and others. Report of the conference on low blood cholesterol: Mortality associations. Circulation 86, 1046–1060, 1992.
16) Iribarren C and others. Serum total cholesterol and risk of hospitalization, and death from respiratory disease. International Journal of Epidemiology 26, 1191–1202, 1997.
17) Iribarren C and others. Cohort study of serum total cholesterol and in-hospital incidence of infectious diseases. Epidemiology and Infection 121, 335–347, 1998
18)Claxton AJ and others. Association between serum total cholesterol and HIV infection in a high-risk cohort of young men. Journal of acquired immune deficiency syndromes and human retrovirology 17, 51–57, 1998.
19)Neaton JD, Wentworth DN. Low serum cholesterol and risk of death from AIDS.AIDS 11, 929–930, 1997.